No products
Product successfully added to your shopping cart
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we consider that you are accepting their use if you keep browsing the website.

Médiologie
- New Art Books
- Exhibition catalogue
- Highlights
- Art Book Sale
- Museum's Shop & Gifts
- Bilingual art books and foreign editions
- Children's Books
- Art History
- Painting
- Architecture
- Sculpture
- Drawing & Engraving
- Photography
- Contemporary art
- Decorative Arts & Design
- Art Techniques
- Critics
- Entertainment art books
- Civilisations
- Partners Reviews
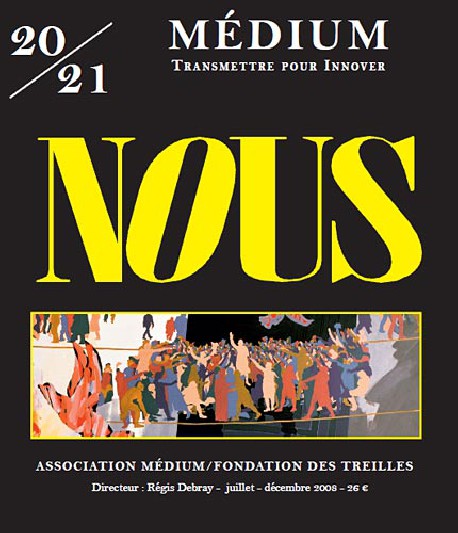
Revue Médium N°20-21 : NOUS - juillet-décembre 2009
Revue trimestrielle dirigée par Régis Debray. Sommaire : Nous les poissons par Pierre d’Huy ; Nous la cellule amoureuse par Daniel Bougnoux ; Nous les dominicains par Antoine Lion ; Nous les grands corps par Noël de Saint Pulgent ; Nous les communistes par Gérard Belloin ; Nous les ligueurs par Paul Soriano ; Nous les Européens par Stephen Spoiden (...).
Product not available
| Model | 1600000210004 |
| Artist | Médiologie |
| Author | Sous la direction de Régis Debray |
| Publisher | Editions Babylone |
| Format | Broché |
| Language | Français |
| Dimensions | 190 x 170 |
| Published | juillet-décembre 2009 |
Ouverture
Un lieu pour faire lien par Maryvonne de Saint Pulgent
NOUAGES
Nous les poissons par Pierre d’Huy
Commençons par l’observation des grégaires intermittents. Pour s’ouvrir à quatre questions. Qu’est-ce qui lie et délie le groupe ? Qu’est-ce que l’individu gagne et perd avec lui ? Comment l’individu se fait-il accepter et se maintient-il en groupe ? Qui le dirige ? Tentons l’aventure.
Dans la nature, les premiers animaux qui viennent à l’esprit quand on parle de groupe sont les célèbres grégaires qui vivent en colonies sociales stables, comme les abeilles, les fourmis ou les termites. Dès 1911, on les nomme superorganismes. Ils sont très interdépendants et rigoureusement organisés en castes spécialisées. Ils sont capables de communiquer entre eux de façon très efficace, comme l’a démontré Karl von Frisch, colauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine 1973, avec le décryptage de la danse des abeilles. Mais nous nous détournerons de ce type de groupe afin de nous concentrer sur ceux qui sont constitués d’individus passant la majeure partie de leur existence solitairement. Ils restent dans l’absolu toujours indépendants, mais choisissent à certaines périodes de leur vie d’adhérer au groupe. Ils constituent la norme, puisque près de 80 % des animaux se regroupent avec leurs contemporains pour une raison ou pour une autre à une certaine période de leur vie. Historiquement, les premières études sur les animaux grégaires furent lancées pour des raisons pratiques. Les plaies, principalement les insectes migrateurs, et les proies, comme les bancs de poissons ou la migrations des vols de pigeons. Cela explique leur précocité. Le criquet migrateur, Schistocera gregaria, fut ainsi étudié dès les années 20 par Boris Uvarov après les catastrophes qu’il infligea aux moissons en Ukraine. Il put démontrer que le criquet pèlerin vit seul jusqu’à une certaine densité et une certaine saison. Il en va de même pour certains poissons, pour certains oiseaux.
Pierre d’Huy dirige le MIP (Management Institute of Paris), école de management, enseigne au Celsa Paris IV-Sorbonne, il est consultant international en management de l’innovation. Dernier ouvrage paru, L’Innovation collective, Éditions Liaisons sociales, 2003 et 2007.
Nous la cellule amoureuse par Daniel Bougnoux
De l’auteur du Libertinage au chanteur lyrique des poèmes à Elsa, du romancier qui fixa dans Les Cloches de Bâle ou Aurélien d’inoubliables amours jusqu’au vieillard homosexuel de Théâtre-roman, quels usages de l’amour propose Aragon, et que nous apprend-il d’essentiel sur le nouage érotico-politique ?
Aimer, dans toutes les acceptions de ce verbe, apparaît comme la condition d’institution du sujet, mais cette fondation le complique en le jetant hors de lui, en le faisant dépendre et en lui rappelant sa foncière incomplétude, son irréparable inachèvement. Pour son bonheur ou son pire malheur, le sujet amoureux est ouvert, et il cherche : « Ce que nous cherchons est tout. » Cette quête de l’infini ou du sublime, particulièrement frénétique dans les textes des années 20, enlace étroitement éros avec thanatos dans la mesure – la démesure – où un désir ainsi orienté ou fixé ne peut que détruire son objet, ou son sujet, qui ne sont jamais « tout ». On devine que la « correction » réaliste, l’amour monogame d’Elsa autant que l’intransigeante adhésion d’Aragon à un PCF auquel il restera fidèle jusqu’à sa mort (1982), opposés comme une digue au délire précédent, n’auront pas vraiment calmé le jeu.
Daniel Bougnoux est professeur émérite à l’université Stendhal de Grenoble.
Nous les dominicains par Antoine Lion
Le couvent dominicain de Saint-Jacques, à Paris (1218), a huit siècles d’existence. Antoine Lion en a fait partie au cours des quarante dernières années. Il répond ici à la question : Comment une identité religieuse traverse-t-elle les siècles ?
Quelques repères à l’usage du lecteur peu familier de cette « multinationale » originale qui compte aujourd’hui environ six mille cinq cents hommes dans une centaine de pays, dont quatre cent cinquante en France – pour ne rien dire des dominicaines ni des laïcs dominicains. Vers 1170, à Caleruega, village de Haute-Castille, vient au monde un certain Domingo de Guzmán, que la postérité appellera saint Dominique. Devenu prêtre, puis chanoine d’un modeste diocèse, Osma, il s’établit en Occitanie et fonde en 1207 à Prouilhe, près de Carcassonne, un monastère de sœurs cloîtrées qui existe toujours. Prédicateur itinérant, il tente d’opposer la force de la parole nue à l’hérésie des Albigeois, plutôt que de recourir aux violences qui seront bientôt préférées par l’Église. L’Inquisition ne naîtra que dix ans après la mort de Dominique. Le groupe grandissant, Dominique se voit contraint de l’organiser. En 1215, il s’en va négocier à Rome, non sans peine, l’autorisation de fonder un nouvel ordre religieux, les Frères prêcheurs. L’épithète constitue ontologiquement ses membres dans l’activité de prédication. Ordo Fratrum Praedicatorum, ce sera – et c’est toujours – le nom de cette fondation, même si le mot « Dominicains » l’emportera dans le langage courant.
Antoine Lion, polytechnicien, est dominicain au couvent de Saint-Jacques. Il a fondé l’association Chrétiens & sida et fut membre du Conseil national du sida. Il a dirigé de 1988 à 2000 le centre Thomas-More au couvent de La Tourette, près de Lyon. Il a récemment édité Marie-Alain Couturier, un combat pour l’art sacré (Serre Éditeur, Nice, 2005) et prépare une biographie du père Couturier.
Nous les grands corps par Noël de Saint Pulgent
Objets de fantasmes et parfois de lazzi, les micro sociétés que sont les grands corps de l’État veillent sur l’intérêt général. Nos grands commis ont leurs rites et leurs connivences. Voyage au cœur d’une exception française que le monde nous enviait naguère, mais désormais contrainte de s’adapter. Sous la conduite éclairée d’un haut fonctionnaire autorisé.
« La robe est le vêtement décent entre tous, le vêtement rationnel du Professeur ; elle témoigne d’une parenté intellectuelle entre tous ceux qui la portent ; elle est le signe sensible de l’esprit de corps », disait Achille Mestre, éminent professeur de droit public du siècle dernier.Je pense souvent à cette citation en voyant exposé à l’entrée du service de l’inspection des Finances à Bercy l’uniforme porté, au début du siècle dernier, par un de nos grands anciens, Jacques Bizot, lors d’une mission qu’il effectua à Téhéran comme conseiller financier auprès du gouvernement persan. Pour tous les visiteurs, ce totem placé en exergue marque en quelque sorte l’entrée sur le territoire de l’inspection. Et c’est d’autant plus paradoxal et significatif du symbole que représente l’uniforme que celui-ci, disparu depuis longtemps, n’a jamais joué un grand rôle dans l’histoire de l’inspection des Finances, à la différence de ce qui peut être observé pour d’autres corps, comme le corps préfectoral, sans oublier la robe des magistrats de la Cour des comptes.
Noël de Saint Pulgent est inspecteur général des Finances.
Nous les communistes par Gérard Belloin
Comment faire les pires choses avec les meilleures intentions du monde ? Comprendre l’« esprit de parti » exige de déposer sur le divan la faucille et le marteau. La lucidité d’un ancien permanent nous aide à psychanalyser un mal du siècle.
L’individu exalté par le groupe oublie tout ce qu’il lui sacrifie. Les militants font un rêve. À quel prix ? Précisons immédiatement qu’il convient de distinguer les adhésions de ceux qui constituèrent l’« actif du parti » (son noyau stable) et celles qui firent du PC un « parti de masse » et quelque peu « attrape-tout » (adhésions pour le temps d’une campagne ou pour un objectif limité, et affectées d’un rapide turnover). Nous ne nous intéresserons qu’aux premières. Incontestablement, l’engagement ouvrait un nouvel horizon au militant ; et quel horizon, puisque le communisme se présentait comme une nouvelle étape du développement de l’humanité devant aboutir à sa réconciliation avec elle-même. Société d’abondance, monde sans conflit et homme nouveau… L’idéal était d’une totale perfection et ouvrait, pour le quotidien, un champ infini à l’action personnelle. L’engagement communiste a été, pour ses adeptes, le facteur déclenchant d’une incontestable promotion culturelle. « De l’horizon d’un seul à l’horizon de tous » : Éluard a pointé la profondeur du remaniement de la personnalité qu’opérait l’engagement communiste.
Gérard Belloin a été cadre permanent du PCF jusqu’en 1979. Journaliste, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Mémoires d’un fils de paysans tourangeaux entré en communisme, Éditions de l’Atelier, 2000, et La Faucille, le marteau et le divan, Éditions du Rocher, 2009.
Nous les ligueurs par Paul Soriano
La Ligue du Nord à l’italienne témoigne du conflit des allégeances qui affecte de nos jours l’animal politique sollicité par des « nous » hétérogènes, entre fraternité réduite au semblable, résilience du « nous » national et interpellation universaliste des droits de l’homme.
Pour le meilleur et pour le pire, l’Italie est un laboratoire de la politique, des premières communes libres au totalitarisme, de Machiavel à Malaparte, auteur d’une Technique du coup d’État qui en actualise la dimension médiologique, plus d’un demi-siècle avant que Berlusconi n’invente la démocratie en vidéosphère. À l’encontre d’une idée inspirée par le malgoverno de l’après-guerre, les Italiens ne souffrent nullement d’incompétence, mais plutôt d’incontinence politique.
Paul Soriano est chargé de mission « études et recherches » à la direction de la stratégie du groupe La Poste. Dernier livre publié : Internet, l’inquiétante extase, avec Alain Finkielkraut (Mille et Une Nuits, 2001).
Nous les Européens par Stephen Spoiden
Comment des « nous » européens peuvent-il en faire un seul ? On a commencé par l’économie, mais comment donner à l’Europe une cohésion symbolique ? Si être c’est s’opposer, d’où surgira l’être européen, entre l’Amérique et le monde arabo-musulman ? D’un renoncement peut-être aux arbitrages militaires, au profit d’un renforcement des normes et du droit ?
Le fait est établi dans de nombreuses disciplines des sciences humaines, et la notion est largement partagée en Europe : les grands groupes humains (nations, ethnies) se nouent principalement par un processus d’opposition et de différenciation qui, historiquement, s’est souvent traduit par la fabrication d’ennemis. Le principe de différenciation s’observe dès les origines de la culture européenne : la culture grecque s’est construite contre les Troyens ; Rome, on le sait, a eu ses Barbares. L’Europe, depuis ses réels débuts, au Moyen Âge, est faite de marches et n’est pas un jeu sans frontières. Ce qui paraît comme une évidence et suscite peu de discussion sur le Vieux Continent, et donc ne mériterait pas que l’on s’y arrête ici, est cependant mal reçu en dehors de l’Europe, notamment aux États-Unis et particulièrement dans les cercles universitaires bien-pensants (également en Europe). Les promoteurs de multiculturalisme et de tolérance, pour qui la création d’une identité par opposition, quelle qu’elle soit, rappelle la vieille Europe des nations et ses vieux antagonismes, y voient un processus dangereux d’exclusion, générateur de ressentiments durables et de conflits. Et sans doute tout cela rappelle-t-il au monde universitaire les réflexions extrêmes de Carl Schmitt à propos du rapport ami-ennemi dans la constitution des États et du concept de « la guerre de tous contre tous ».
Stephen Spoiden dirige le programme français du département de sciences humaines à l’université du Michigan à Dearborn, où il enseigne depuis 1996. Il a publié La Littérature et le sida. Archéologie des représentations d’une maladie (Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2001). Membre du comité éditorial de la revue Contemporary French Civilization. Correspondant de Multitudes aux États-Unis.
NODULES
La génération par Pierre-Marc de Biasi
Degré zéro de l’appartenance, la génération en est peut-être la forme la plus active : c’est un destin. Il hante et structure un célèbre roman d’amour.
Madame Bovary est un roman d’amour, d’accord. Mais c’est aussi un texte de combat où Flaubert règle ses comptes avec sa propre génération, et tout particulièrement avec l’imposture des belles âmes romantiques qui, après avoir raté deux révolutions, viennent de plébisciter un coup d’État sanglant livrant la nation à la toute-puissance d’un régime policier : le gang de l’Élysée, chargé de protéger les affaires et de donner toutes ses chances à la révolution industrielle. Les adulateurs de Byron et des edelweiss, les sectateurs des clairs de lune et des voyages en Italie, ont finalement fabriqué une société sans états d’âme qui envoie les enfants à l’usine et les poètes en exil. Le sujet romantique a retourné sa veste et la génération des bonnets rouges a abdiqué le culte de l’inspiration et de la révolte pour se soumettre au cliché du consensus : « Bras : pour gouverner la France, il faut un bras de fer » (Dictionnaire des idées reçues). Comment en est-on arrivé là ? Par quelle fatalité une génération en vient-elle à trahir son idéal ? C’est à cette question que L’Éducation sentimentale de 1869 sera tout entière consacrée, vingt ans après les événements. Mais, entre 1851 et 1857, c’est déjà pour une part à la même question que Flaubert tente de répondre, à chaud, dès les premières années de l’Empire autoritaire, dans un roman sentimental qui ne manquera pas de le conduire illico devant les tribunaux. C’est bien connu : Madame Bovary est un récit déserté par l’histoire, où les traces de la chronologie sociale et politique sont exceptionnellement rares. C’est bien connu aussi : Madame Bovary commence par un topos, les enfances scolaires du héros au collège. Ce qui est moins connu, c’est le traitement très étrange que Flaubert, sans y paraître, fait subir à ce topos pour le métamorphoser en un véritable symbole : la logique historique du processus par lequel s’est noué et dénoué le nous de toute une génération.
Pierre-Marc de Biasi est artiste plasticien et directeur de recherche au CNRS, spécialiste de Flaubert et de critique génétique. Il dirige l’Institut des textes et manuscrits modernes à l’ENS de la rue d’Ulm.
Le Clan par Michel Erman
La construction du sanctuaire mondain (noyau, clan, salon) met en lumière les lois du collectif. Généralissime de la guerre sociale, madame Verdurin préfigure les valeurs et tactiques de l’ordre politico-médiatique.
Proust ne professe aucune doctrine politique. Il considère le monde social de la Belle Époque comme un « kaléidoscope » composé de fragments de « mouvements artistiques, de crises politiques », et marqué par les goûts changeants du public. Le réel est pour lui une force active qui voit les désirs individuels façonner le collectif. Et ce n’est pas tant la question du « pourquoi » et du conditionnement qui l’intéresse que celle du « comment » et de l’imitation – on sait que Proust fut un lecteur fervent de Gabriel Tarde, qui faisait de l’imitation l’un des principes de la vie sociale. Comment devient-on dreyfusard ? Comment fait-on clan ? Comment passe-t-on du clan au salon ? Fils d’un médecin humaniste et laïque – Adrien Proust conseillait le gouvernement pour les questions sanitaires en même temps qu’il donnait des consultations gratuites à l’Hôtel-Dieu – qui se sentait proche, dans les années 1880, des radicaux, lesquels réclamaient une « République démocratique et sociale », et d’une petite-nièce d’Adolphe Crémieux, Marcel Proust a reçu une éducation libérale. Républicain, laïque et ardent dreyfusard, bien qu’il lui arrivât d’écrire par opportunisme dans Le Gaulois, journal monarchiste, il ne sera jamais, au contraire de la plupart de ses amis, un anticlérical militant : lorsque Émile Combes prive les congrégations du droit d’enseigner et fait procéder à l’expulsion des religieux, Proust désapprouve vivement cette politique ; lors de la séparation de l’Église et de l’État, il prend fait et cause, dans un article du Figaro publié sous le titre : « La mort des cathédrales », pour l’architecture et l’art religieux menacés de devenir des musées sans vie. Si dans son roman l’église Saint-Hilaire de Combray, qui « résume » à elle seule toute la ville pour l’amateur de paysage, est présentée comme la marque de la francité, il ne faut pas se méprendre. Il s’agit pour Proust de dire une identité culturelle qui permet la rêverie poétique, et non pas une identité politique : le clocher de l’église est différent selon la perspective dans laquelle il s’offre au regard, comme le sont les « Meules » d’un Monet. Le romancier est assez indifférent à l’histoire (il s’intéresse au temps, ce qui est sensiblement différent), car, au fond, l’homme est un sceptique ; il pense que, quoi qu’il en aille de la réalité des faits en politique, ceux-ci feront toujours l’objet d’interprétations divergentes selon les intérêts partisans des uns ou des autres : quand on croit atteindre la vérité politique, elle se dérobe (II, 538).
Michel Erman est professeur de linguistique et de poétique à l’université de Bourgogne. Il travaille en particulier sur le discours politique. Dernier ouvrage paru : Poétique du personnage de roman, Ellipses, 2006.
La troupe par Jacques Lecarme
Tout comme la paix marque le retour au « on », la littérature de guerre illustre excellement le passage du « je » au « nous ». Allemands et Anglais se montrant, sur ce chapitre, plus convaincants que les Français…
L’hymne national de nous autres, Français (qui n’est pas par hasard un chant de marche guerrière), nous enjoint : « Allons, enfants de la patrie… »
L’énonciateur ne parle pas au nom de son moi haïssable, mais du nous patriotique, nous sacré entre tous dès lors que la patrie est en danger et que tout un chacun devient un « être-pour-la-mort ». La première personne du pluriel, sur le mode impératif, appelle une synthèse des sujets singuliers, euphorique ou tragique, et une adhésion mystique de chaque sujet à l’ensemble collectif qui le transcende et le justifie. Le singulier et le pluriel se réconcilieraient ainsi dans ce « nous » d’un exorde qui est aussi « exportation ». car cet hymne national ne constitue qu’un serment pour une communauté créée par la guerre d’aller jusqu’au meurtre et à la mort, « nous » contre « eux ». Et sans un serment on voit mal comment se nouerait un nous qui serait autre chose qu’une formule de politesse civile.
Jacques Lecarme est professeur émérite de littérature française à l’université Paris III. Dernier livre paru : L’Autobiographie, avec Éliane Lecarme-Tabone (Armand Colin, 2004).
La chorale par Catherine Bertho-Lavenir
Le chœur est une singulière façon de faire corps. Ce « nous » recomposé assigne à chaque chanteur une place et une tâche précises. C’est dans la mise en œuvre de la partition que se fabrique le passage du « je » au « nous ». Étude de cas.
Prenons deux chœurs, l’un à Montréal, l’autre à Versailles. Homogénéité suffisante du recrutement : des dames (beaucoup) et des messieurs (peu) appartenant à la moyenne bourgeoisie catholique ou protestante, plus quelques agnostiques de bonne composition et des ténors indifférents au fait religieux. Le répertoire est dans les deux cas analogue : du Vivaldi, du Bach, du Mendelssohn, et tous ces musiciens qui ont alimenté les grandes cérémonies chrétiennes en airs de circonstance au cours des trois siècles passés. Comment ces partitions transmises par la tradition d’une culture musicale occidentale produisent-elles aujourd’hui du nous à l’ombre des temples protestants français et des églises québécoises ?
Catherine Bertho-Lavenir est, avec Frédéric Barbier, l’auteur d’une Histoire des médias, de Diderot à Internet, Armand Colin (dernière édition, 2004). Professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris III-Sorbonne nouvelle, elle s’est occupée en 2007 de la chaire Étude de la France contemporaine à l’université de Montréal.
L’équipe par Robert Damien
Nous parlons d’esprit scientifique, d’esprit des lois, des peuples, d’esprit de corps et même d’Esprit-Saint pour qualifier ce qui inspire une totalité agissante, qui dépasse quelquefois ce qu’on en attendait. De même que l’esprit vient aux jeunes filles, l’esprit vient à l’équipe. Par quels voies et moyens ?
Ç a vient, ça va venir, allez, allons-y, « ça ira, ça ira », comme dit la chanson sans qu’on sache vraiment d’où cela vient ni où cela va. Esprit de corps, es-tu là ? Rien n’est moins sûr car souvent il s’étiole, il est épuisé avant même de naître. Chacun se sent à la fois miteux et calamiteux dans ce groupe désagrégé où rien ne semble gouverné, où il n’y a ni gouvernail ni gouvernement, tout part à vau-l’eau. On se sent alors le corps lourd, empoté, avec la conscience aiguë de ses insuffisances, on se met à s’écouter, on a mal de partout, on se plaint, on récrimine, on ne pense qu’à soi, ses petits malheurs, ses petits bobos. On a l’impression douloureuse que tout « fout le camp », part au néant, que chaque initiative est vouée à l’échec, tombe dans le vide…
Robert Damien est professeur de philosophie à l’université de Nanterre. Dernier livre paru : Le Conseiller du Prince, de Machiavel à nos jours, PUF, 2004.
Le lycée par France Renucci
Sous une forme minuscule et brouillonne, le journal du lycée marque la première cristallisation d’un « nous » extrafamilial. Il a ses lettres de noblesse. Mais de rebelle qu’il était, le voilà devenu officiellement recommandé.
Dans un documentaire sur Marcel Proust produit par la RTF au début des années 60, Daniel Halévy raconte qu’ils étaient condisciples au lycée Condorcet : « Il était bien là, du lycée, mais il ne semblait pas tout à fait des nôtres. » Halévy trouvait Proust un peu poseur. En propédeutique, quelques élèves décident de fonder une revue, Le Banquet, et demandent à Proust un article qui, une fois écrit, est refusé au motif que « Proust était devenu un homme du monde ». Cette exclusion trace la frontière du groupe, du nous, si fragile soit-il, que constituait l’équipe fondatrice de ce journal lycéen.
France Renucci est maître de conférences à Paris-Sorbonne et directrice du Clemi (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information).
Le mouvement par Marcel Bénabou
Des bricoleurs ont fait brigade, une petite bande est devenue un collectif rayonnant qui a imposé sa marque dans le champ littéraire. L’Ouvroir de littérature potentielle offre un bel exemple de nouage d’un « nous ».
L’Oulipo chemine allégrement vers la cinquantaine, un âge vénérable qu’il devrait normalement atteindre le 24 novembre 2010. La cinquantaine de siècles, s’entend, car il est depuis longtemps admis qu’une année oulipienne, en raison de l’énergie intellectuelle qui s’y dépense, en vaut cent. C’est là, on nous l’accordera, une longévité remarquable, et que les commentateurs manquent rarement de remarquer et de commenter. Qu’en est-il donc exactement de cette brigade de bricoleurs des lettres, dont on ne retient trop souvent que quelques figures de proue médiatiquement consacrées (le trio Queneau, Perec, Calvino), et dont les travaux multiformes, mêlant inextricablement le sérieux et le ludique, ont suscité, au fil des ans, des réactions contrastées : un intérêt passionné et complice chez certains, une condescendance amusée chez d’autres, et chez d’autres encore le plus rageur des rejets ? Les remarques qui suivent voudraient attirer l’attention sur quelques aspects de la vie passée et présente du groupe.
Marcel Bénabou, professeur émérite d’histoire ancienne à l’université Paris-Diderot, est depuis 1970 le « secrétaire définitivement provisoire » de l’Oulipo. Au nombre de ses publications récentes : Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres, PUF, 2002 (deuxième édition) ; Écrire sur Tamara, PUF, 2002 ; L’appentis revisité, Berg International, 2003 ; Oulipo Anthologie, Gallimard, 2009 (avec Paul Fournel).
NUAGES
La télé par Thomas Weber
La télévision, comme chaque média, forme son propre public : elle crée un « nous » qui ne se réduit pas à une addition d’individus. Mais les signes de dissolution apparaissent aujourd’hui au sein de ce « nous télévisuel », en proie à de nouvelles formes d’hybridation et de transformation.
Il n’existe pas de césure précise et définissable pour qualifier cette « dissolution de la télévision ». Elle ne peut pas simplement être mesurée à l’aune du succès d’Internet, car la télévision rencontre encore – et surtout ces dernières années – une grande expansion. La notion de dissolution ne veut pas non plus exprimer la disparition de la télévision, mais plutôt une mutation de sa fonction, un changement de son état d’agrégat, comme un morceau de sucre qui fond dans l’eau. Il s’agit plutôt de la dissolution de la structure des programmes proposés par la télévision et de l’organisation du temps qui en découle au quotidien, comme de la modification de la dramaturgie de certaines émissions, des formes de distribution et d’exploitation, ainsi que des modèles d’orientation de son public. Les raisons de cette évolution sont liées aux nouvelles technologies, mais aussi à une modification spécifique de la structure des spectateurs. L’âge moyen des spectateurs est déjà de cinquante ans aux États-Unis, de cinquante et un ans en Allemagne, et, pour les organismes de radiodiffusion publique allemands, il atteint même cinquante-neuf ans. La télévision comme média est un phénomène de génération ; il est prévisible que, telle que nous la connaissons actuellement, elle disparaîtra avec notre génération. Car les jeunes préfèrent ce que l’on appelle les nouveaux médias. La télévision ne représente déjà plus qu’un média parmi d’autres. Si l’on a pu qualifier un journal télévisé, comme celui de PPDA, de « grand-messe », regardé par une large partie de la population, cela ne concerne aujourd’hui que la tranche de population la plus âgée. L’hybridation et les transformations des conditions organisationnelles et institutionnelles de la télévision, ainsi que de ses modes de pensée culturels, modifient ainsi l’orientation des diverses constructions du « nous ». Nous examinerons donc successivement trois transformations majeures de la télévision qui agissent sur les communautés télévisuelles : la collision des critères dans la politique des médias ; le rapport de la télévision à la réalité et sa crise d’authenticité ; la dissolution du public en communities fragmentées.
Thomas Weber est, depuis 1998 collaborateur scientifique à l’Institut des sciences de la culture et de l’art à l’université Humboldt de Berlin, et PDG de la maison d’édition Avinus.
La Toile par Louise Merzeau
Parce que mondes réel et virtuel sont solidaires, les pratiques réticulaires affectent les régimes de l’être-ensemble, non seulement par contestation ou court-circuit, mais aussi par contamination. Qu’on soit connecté ou non, notre vie sociale, publique ou privée, sera de plus en plus régie par les logiques de traçabilité, de recyclage et d’interactivité induites par la gestion numérique de nos rapports. Identité, légitimité, responsabilité…, l’ensemble des droits de cité sont appelés à se redéfinir, par réaction, hybridation ou mutation.
Pour comprendre en quoi la « grande conversion numérique » modifie l’organisation de la cité, il faut renoncer à voir le Net comme « une sorte d’isolat communicationnel » où se construirait ex nihilo un idéal démocratique inédit, à côté du monde réel. Outre que les internautes restent soumis aux contraintes civiques, juridiques et administratives ordinaires, le cyberespace est lui-même ancré dans le tissu industriel, économique et politique dont il procède. Inversement, les règles élaborées sur le réseau sont rapidement reportées sur les pratiques usuelles d’action, d’échange ou d’adhésion hors connexion.
Erratum : suite à une erreur de fabrication, de nombreuses notes comportant des références de citation ont sauté dans la version papier de cet article. Ces omissions sont corrigées dans la version en texte intégral disponible ICI
Louise Merzeau est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à Paris X et photographe. Dernier livre publié : Au jour le jour, Descartes et Cie, 2004.
Le réseau social par Karine Douplitzky
Septembre 2008. Le site Facebook vient de passer le cap des 100 millions d’utilisateurs dans le monde – un exploit, pour une société créée il y a seulement quatre ans. Plus qu’un phénomène de mode, nous voyons, dans cette montée des réseaux sociaux, l’annonce d’un changement en profondeur de la Toile, qui s’oriente vers le tout « social » – un adjectif certes à la mode, qui envahit la presse anglo-saxonne (« social media », « social research », « social-shopping», « social advertising», etc.), mais qui révèle toutefois le nouage de nouvelles formes du « nous ».
Alors que le krach des années 2000 laissait à penser que l’âge d’or d’Internet était passé, que Google était indélogeable et que la Toile allait s’alanguir dans un train-train commercial, voici de nouveaux acteurs qui apparaissent sur la scène numérique, avec une vitalité renouvelée et des taux de croissance de 150 % ! Qu’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit pas de quelques geeks dans un garage, mais d’entreprises qui séduisent des millions d’internautes. Ces sociétés affichent des chiffres d’affaires galopants, avec une rentabilité moyenne de 30 % par rapport à leur chiffre d’affaires – ce que bien des entreprises du monde réel rêveraient d’atteindre (l’édition, à titre de comparaison, caracolant autour de 5 %). Citons, pour convaincre les sceptiques, les performances actuelles de trois grands réseaux sociaux américains : Facebook (100 millions de membres), 300 à 350 millions de dollars de chiffre d’affaires, valorisé 15 milliards de dollars ; MySpace (230 millions de membres), 500 millions de dollars de chiffre d’affaires, valorisé 5 à 10 milliards de dollars ; LinkedIn (24 millions de membres), 60 millions de dollars de chiffre d’affaires, valorisé 1 milliard de dollars.
Karine Douplitzky est réalisatrice et écrivain, spécialiste des nouveaux médias.
NOUS AUJOURD’HUI
Trois questions posées à…
1. Vous formez partie d’un collectif. Cette appartenance vous rend-elle heureux ?
2. Cette identité collective vous donne-t-elle le sentiment de vous limiter ? En un mot,
peut-elle aussi vous rendre malheureux ?
3. Voyez-vous des améliorations à apporterà votre communauté d’adoption ?
Matignon par Dominique de Villepin
Pour un gouvernement, la mise en veille des considérations de confort ou de tranquillité personnelle est une condition préalable. Matignon est un tourbillon permanent qui nécessite un engagement de tous les instants, donc une santé de fer et une mobilité d’esprit, indispensables pour consulter et décider. Si, selon l’adage, gouverner c’est choisir, conduire un gouvernement oblige à se dévouer tout entier au bien commun. Ce sacrifice du je au nous peut se définir comme la poursuite de l’adéquation entre l’action personnelle et la recherche de l’intérêt général. C’est à la fois un exercice d’une grande solitude – car dans les moments de décision elle est extrême – et une vie d’équipe permanente, à l’échelle du cabinet comme à celle du gouvernement, qui crée bien sûr des tensions mais aussi des solidarités et des rencontres humaines extraordinaires.
Dominique de Villepin, ancien Premier ministre.
La région par Michel Vauzelle
La faiblesse de l’homme est dans la douloureuse contradiction entre sa condition de mortel et sa condition, selon certains, de fils de Dieu. Sa solitude absolue, dans cet état, le contraint généralement à chercher à répondre au besoin vital et impérieux « d’être lui » parmi d’autres, « visibles moi », certes, mais dans le « nous ». La vie est en réalité la mort à petit feu, et la mort serait, toujours selon certains, la libération vers la vie, la vraie, après la résistance d’une mort annoncée.
Michel Vauzelle, ancien Ministre, député, président socialiste de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 1998 et président de l’Eurorégion Alpes-Méditerranée.
Heureux, très probablement. Disons que si je n’avais pas été distingué comme Compagnon, je ne m’en serais jamais remis. Pourquoi ? Parce que je suis parti pour Londres en juin 40 dans le but de faire la guerre et que je n’ai jamais pu me battre les armes à la main, comme beaucoup des copains de mon âge de la France libre, Yves Guéna, par exemple, ou François Jacob, avec lesquels je m’entraînais. C’est la tache de ma vie. J’ai été parachuté en France comme agent secret, je suis devenu le secrétaire de Jean Moulin, mais je n’ai jamais porté l’uniforme sur le territoire ou ailleurs, dans un maquis ou une unité régulière. Quand je suis revenu à Londres, en mai 43, après deux mois passés en prison en Espagne, je n’avais qu’une idée en tête, rejoindre une unité combattante, et non revenir en France. Mais j’ai dû rester au BCRA, au service d’action, même si sur les quatre cents membres de ce service restés à Londres (la direction était déjà à Alger) je n’en connaissais plus que deux ou trois. Les autres étaient morts ou arrêtés.
Daniel Cordier,né à Bordeaux, dans la Gironde, le 10 août 1920, est un Français libre, marchand d’art et historien français. Très proche collaborateur de Jean Moulin dans la Résistance, il lui a consacré une biographie en plusieurs volumes qui a fait date. Son dernier livre : Alias Caracalla, Gallimard, 2009.
Le Quai par Alain Dejammet
Le cabriolet roule à toute berzingue sur la RN 10, Bordeaux-Paris, radio hurlante. Au volant, un diplomate marocain. À sa droite, Christine Bourgois, alors stagiaire de l’ENA à la préfecture de la Gironde. Derrière, terrorisé, l’auteur de la réponse à ce questionnaire. Devant nous, un camion très large que notre véhicule fou prétend doubler. En face avance, klaxon bloqué, un autre camion. À l’ultime seconde, dans un crissement de pneus qui brûlent, les trois engins parviennent à stopper. Alors, de la cabine des deux camions descendent d’impressionnants chauffeurs en costume du temps, marcel, salopette. De part et d’autre du petit bolide, encore fumant de stupeur, s’engagent dans l’habitacle deux bras énormes qui cherchent le bouton de la radio, le tournent. Et dans le silence accablant, les deux routiers, reculant de quelques pas, déchiffrent la plaque diplomatique, CD, et assènent, impérieux, méprisants, avant de tourner les talons : « Pédés… » À l’époque (très lointaine, avant toute une série de lois), ce n’était pas un compliment. C’était aussi mon premier contact avec le corps diplomatique et sa réputation. Il ne rendait pas fier.
Alain Dejammet, ambassadeur de France.
Le monastère par Frère Anselme
Oui, j’en éprouve une certaine fierté ; je ne la rapporte pas à ce que je suis moi-même : elle me vient avant tout de l’estime que j’ai pour ce collectif auquel j’appartiens et auquel je dois d’être, aujourd’hui, assuré à la fois dans ma propre identité et dans ce qui, sans la détruire, lui donne un sens qui la dépasse. « L’ensemble de cette escadrille est plus noble que presque tous ceux qui la composent » ? En l’occurrence, il vaudrait mieux parler d’escadron que d’escadrille (nous sommes soixante !). Mais l’important n’est pas là. Il réside en ce que la fierté de se situer dans une tradition qui a fait longuement ses preuves à travers les siècles ne va pas sans le sentiment que ce bonheur reste emprunt de la fragilité de ceux qui le poursuivent. En sorte que le problème ne se pose pas tant au niveau des structures qu’à celui des personnes selon qu’elles sont plus ou moins prêtes à se convertir à leur propre religion.
Frère Anselme est moine bénédictin de l’abbaye d’En Calcat.
La loge par Charles Conte
Que du bonheur ! Mais comment faire comprendre la façon dont il est généré par mon adhésion – mon appartenance – à la franc-maçonnerie ? Peut-être en relatant simplement l’histoire de ma relation avec la Fraternité. Les Anglais – qui n’ont pas toujours tort – désignent ainsi (The Brotherhood) l’ordre maçonnique, composé de l’ensemble des obédiences dans le monde. Cette histoire est celle d’une séduction progressive. Longtemps je suis resté réservé à l’égard de la franc-maçonnerie. Amusé par ses symboles. Agacé par ses cachoteries. Indigné par son refus de la mixité. Libre penseur, militant laïque, proche du mouvement libertaire, je cohabitais pourtant avec des francs-maçons… et des anti-francs-maçons, plus nombreux qu’on ne le pense. Le mouvement libertaire, en particulier, fut le lieu d’affrontements pas seulement intellectuels, certains anars n’hésitant pas à condamner la franc-maçonnerie comme cheval de Troie de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier. D’autres en sont des adeptes fervents et voient dans le principe « Le maçon libre dans la loge libre » un fonctionnement libertaire. Le premier d’entre eux à me montrer un visage sympathique de la franc-maçonnerie fut le chansonnier Léo Campion, joyeux drille, notamment fondateur de la Confrérie des Chevaliers du Taste Fesses… Une des nombreuses associations paramaçonniques qui agrémentent ce petit monde.
Charles Conte est membre du comité de rédaction de la revue Humanisme et coordinateur (avec Jean-Robert Ragache) de « Comment peut-on être franc-maçon ? », revue Panoramiques, n° 20, 1er trimestre 1995.
L’armée de terre par Serge Camus
La vie en collectivité est fondamentale dans la bonne marche d’une unité. La cohésion des équipes est au centre de notre travail quotidien, au quartier. Car un jeune caporal ne se bat pas pour de grandes idées, mais pour son frère d’armes. C’est la fraternité d’armes qui le soutient dans le combat, c’est ce à quoi il se raccroche et c’est ce que nous devons cultiver. Sans cette force, pas d’armée de terre.
Serge Camus commande le 4e escadron du régiment d’infanterie-chars de marine (RICM), basé à Poitiers et constitué de cent dix personnes.
Le sous-marin par Stephan Meunier
La fonction de commandant ne prend sens que relativement à un équipage. C’est cette relation forte au groupe qui a justement déterminé ma vocation : quand j’étais jeune élève à l’École navale, je rêvais, comme beaucoup d’autres, de devenir pilote d’aéronef…, mais dans les airs vous êtes seul aux commandes de votre engin, au contraire du sous-marin. Pour ma part, j’ai découvert, au cours de mes stages, que j’avais besoin de faire partie d’un groupe pour m’épanouir. Cette ambiance technique si particulière que l’on trouve à bord d’un sous-marin, où chacun concourt à une mission « extraordinaire » (car il n’y a rien de moins ordinaire que de naviguer sous l’eau), me plaît. Ce qui m’étonne chaque jour, c’est précisément cette capacité du groupe à déjouer la complexité des missions et à surpasser, en puissance, la somme des individus qui le constituent – à condition, toutefois, que les relations humaines, à l’intérieur, aient bien été identifiées.
Le commandant Stephan Meunier a commandé pendant deux ans le Rubis, sous-marin nucléaire d’attaque ; il travaille actuellement à terre sur le projet du Barracuda, le SNA de nouvelle génération en construction ; sa logique de carrière devrait le mener, d’ici peu, à commander un sous-marin nucléaire lanceur d’engins.
La police par Marie Lajus
Petit matin d’hiver à Paris. Quatre policiers transis referment une housse blanche sur le corps d’un jeune motard qui, après plus d’une heure d’efforts du SAMU, vient d’être déclaré décédé. Les agents en uniforme montent le corps dans la fourgonnette de police-secours, direction l’Institut médico-légal. Quelques mots échangés sur le trajet, regards accablés qui se croisent, un jeune policier pose la main sur l’épaule de sa collègue manifestement au bord des larmes. Regards, gestes, confrontation commune avec la violence ou l’épreuve, je crois que j’ai trouvé dans la police quelque chose qui me rappelait à la fois les rapports fraternels d’une famille nombreuse, l’engagement collectif goûté lors d’équipées en montagne ou de camps de jeunesse, le sentiment d’œuvrer ensemble au service des autres, découvert dans l’action associative.
Marie Lajus est commissaire divisionnaire à Paris. Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, elle est entrée dans la police en 1997, où elle a été commissaire en banlieue parisienne puis en services d’enquêtes judiciaires, avant de devenir responsable de la communication de la préfecture de police.
Le gang, propos recueillis par Frédéric Ploquin
Je n’ai pas l’habitude de me justifier, mais puisque tu me le demandes ! Je n’ai pas choisi de devenir ce que je suis. Si j’étais né dans un beau quartier, je serais peut-être devenu chef d’entreprise ou ingénieur. J’ai commencé très jeune, en chapardant, et puis j’ai volé la caisse du premier couvreur qui m’avait embauché parce qu’il avait maltraité sous mes yeux un copain ouvrier.
Frédéric Ploquin est auteur de la trilogie Parrains et caïds, Fayard. Dernier titre paru : Le Sang des caïds. Les règlements de comptes dans l’œil de la PJ (mars 2009).
La musique par Alain Meunier
Plus peut-être que ma profession, c’est l’instrument que je pratique, le violoncelle, qui a fait de moi un individu tourné vers ses semblables. En effet, un instrument monodique tel que violon, violoncelle ou flûte ne donne sa mesure qu’au milieu d’autres instruments, monodiques ou non. Les musiciens jouant d’un instrument polyphonique, harmonique (piano, orgue, clavecin, etc.), peuvent être moins spontanément portés au partage, à la mise en commun, mais la musique a vocation à les rattraper ; vocation dont le signe majeur est justement le partage ! Cette appartenance « obligée » (Dieu merci !) aura sans doute nourri mon amour-propre individuel de façon particulière, le façonnant afin de permettre une rencontre plus heureuse avec les autres, avec l’autre.
Alain Meunier est violoncelliste – soliste et chambriste ; il est très attaché à la transmission de son art, participant à de nombreux classes de maître, festivals ou concours. Il est, entre autres, professeur honoraire des Conservatoires supérieurs de musique de Paris et de Lyon, codirecteur du concours international de quatuor à cordes de Bordeaux.
L’équipe de tournage par Alain Corneau
Dans notre tradition culturelle, le metteur en scène d’un film en est le seul et unique auteur. Dans les faits, la fabrication d’un film est bien le résultat d’un travail d’équipe, une œuvre résolument collective. Il appartient à chaque metteur en scène de résoudre cette contradiction à sa manière, c’est même une des obligations majeures de son activité créatrice. Depuis le couple « réalisateur/producteur » jusqu’à l’écriture souvent à plusieurs, l’intervention de l’équipe technique sur le plateau de tournage, le jeu des comédiens, le montage, musique, sons, étalonnage, etc. le metteur en scène communique à chaque instant avec plusieurs collaborateurs spécialisés.
Alain Corneau, cinéaste.
Le labo par Pierre-Marc de Biasi
Est-ce qu’être chercheur au CNRS a de quoi rendre heureux ? Oui, jusqu’à présent en tout cas, en raison du savant équilibre qui s’y établit entre le je et le nous, à plusieurs échelles et à toutes les étapes de la carrière. En entrant au CNRS, d’abord : les postes sont rares, de dix à cent fois plus qu’à l’université, et l’on peut donc se sentir fier d’avoir été choisi, un peu comme lorsqu’on entre dans une grande école. Être recruté veut dire être « accueilli » par une structure pyramidale de nous : des pairs, une équipe, un laboratoire, un département scientifique (ou, désormais, un « institut »), un comité national et, enfin, au sommet, le CNRS lui-même, comme entité qui fédère toutes les disciplines dans ce qui est à ce jour le plus grand organisme de recherche européen. Le chercheur est coopté et accueilli par ces cercles concentriques de nous pour y développer une recherche individuelle à la fois en son nom propre et au nom de l’unité (le labo) à laquelle il appartient : dans le cadre d’un programme personnel de recherche et à travers des projets collectifs qui rassemblent plusieurs chercheurs, et souvent plusieurs laboratoires, de différentes disciplines, à l’échelle nationale ou internationale. Le nous de proximité le plus naturel pour le chercheur est celui de son laboratoire : une structure à la fois hiérarchique (une direction, un conseil, des chefs d’équipe, des membres statutaires, des membres associés) et démocratique (on devient directeur par élection en soumettant un programme au suffrage de l’unité). Mais le labo ressemble aussi, et de plus en plus (c’est dans l’air du temps), à une sorte de PME à la japonaise, où chacun, avec plus ou moins d’enthousiasme, se sent engagé à relever un défi qui est celui du labo lui-même pour sa survie : produire plus de résultats quantifiables avec des moyens généralement en baisse, innover, développer la structure et son rayonnement international, acquérir de nouveaux moyens financiers et humains par contrats, etc. Là, tout dépend des tempéraments : il y en a que ça stimule, et d’autres que ça stresse…
La rédaction par Antoine Perraud
À la Maison de la radio, sur l’ancien quai de Passy devenu avenue du Président-Kennedy (dans le XVIe arrondissement de Paris), la tour centrale est recouverte, en raison de travaux colossaux, d’une bâche colossale. Sur icelle s’inscrit en lettres immenses : « C’est bien la première fois que nous avons quelque chose à vous cacher. » La formule est fausse (ne songeons qu’à la maladie du président Georges Pompidou, celée de longs mois) et confine donc au cynisme. À la lecture de cette propagande, le salarié de Radio France que je suis change de camp, passant du « nous » trompeur au « vous » trompé, du fait d’une solidarité à la fois instinctive et profonde.
Antoine Perraud, producteur à France Culture, journaliste à Médiapart.fr
Jamais la moindre appartenance à un parti, un syndicat, une secte, une maçonnerie, un comité. Mais quasiment toute ma vie, adhésion à des clubs sportifs, en qualité de pratiquant (foot, rugby, tennis, tennis de table). Des clubs engagés (à un niveau modeste) dans des compétitions officielles. En outre, j’ai présidé pendant dix-huit ans une mini-PME, les Éditions de la Table ronde (une douzaine de salariés). Et je suis un fidèle ordinaire d’une institution assez particulière : l’Église catholique, apostolique et romaine.
Denis Tillinac est un écrivain, éditeur et journaliste. Il a dirigé la maison d’édition La Table ronde de 1992 à 2007. Son dernier livre : La Dernière Clope au Danton.
PENSE-BÊTE (5), par Régis DEBRAY
SALUT L'ARTISTE
Gérard Fromanger
L’atelier fraternel par Régis Debray
Autour de la série Bastilles-dérives par Karine Douplitzky
BONJOUR L'ANCÊTRE
Saint Paul, avec Régis Burnet
UN CONCEPT
Le Barbe-Bleue d’Orient, ou l’homme-fracture, par Pierre Chédeville
Une analogie troublante débouche sur un concept, celui de l’homme-fracture. Les crimes barbares de Gilles de Rais, il y a plus de cinq cents ans, et les attentats de New York, sinistre inauguration du xxie siècle, ont eu, au moment même où ils furent perpétrés, ce triste privilège de métamorphoser immédiatement leurs auteurs en légendes noires de l’Occident. Et pourtant, ni Beria, ni Himmler, âmes damnées autrement terrifiantes, ne sont véritablement devenus des figures populaires du Mal. Pourquoi cette étrange cristallisation sur les crimes d’un grand seigneur de France et d’un fils de grande famille saoudienne ?
Pierre Chédeville a une double formation en management et en littérature. Présent dans le monde de l’entreprise, où il est spécialiste du domaine bancaire, il n’a cependant pas cessé de questionner les grands textes pour essayer d’éclairer de manière décalée le monde contemporain.
SYMPTÔMES
Le théâtre du boulevard par Monique Sicard
Monique Sicard est chercheuse au centre de recherches sur les arts et le langage de l’École des hautes études en sciences sociales. A publié Images d’un autre monde. La photographie scientifique, Centre national de la photographie, 1991, et La Fabrique du regard (XVe-XXe siècle). Images de science et appareils de vision, Odile Jacob, coll. « Champ médiologique », 1998.
Gran Torino par Pierre Chédeville
Pierre Chédeville a une double formation en management et en littérature. Présent dans le monde de l’entreprise où il est spécialiste du domaine bancaire, il n’a cependant pas cessé de questionner les grands textes pour essayer d’éclairer de manière décalée le monde contemporain.
Le journal de Barthes par Jacques Lecarme
Les morts vivants par Régis Burnet et Aliam Karim Rizzi
Le nous dessous-dessous par Daniel Bougnoux
L’invention d’une thébaïde par Danièle Giraudy
UN OBJET
Éloge du rasoir. Introduction à une petite métaphysique de la barbe, par Robert Damien
N’en déplaise à la légende noire de la nouvelle orthodoxie, il y a des utopistes heureux. King Camp Gillette (1855-1932) est de ceux-là : il a changé la face de l’homme. Comment?
Par la mise au point en 1897, après de nombreux tâtonnements de bricoleur, d’un outil utile, facilement manipulable par tous : un rasoir mécanique pour la barbe, de modèle réduit et à prix modique, muni de lames interchangeables à double tranchant enserrées dans une tête démontable. Ce petit appareil bien pris en main autorisait le moindre des hommes à se raser confortablement lui-même la barbe en toute sécurité, chez lui et partout où le travail comme le loisir l’amenaient à se déplacer.
Robert Damien est professeur de philosophie à l’université de Nanterre. Dernier livre paru : Le Conseiller du Prince, de Machiavel à nos jours, PUF, 2004.
Comité de rédaction :
Directeur : Régis Debray
Rédacteur en chef : Paul Soriano
Secrétariat de rédaction : Isabelle Ambrosini
Comité de lecture : Pierre-Marc de Biasi ; Jacques Billard ; Daniel Bougnoux ; Pierre Chédeville ; Jean-Yves Chevalier ; Robert Damien ; Robert Dumas ; Pierre d’Huy ; Michel Erman ; Françoise Gaillard ; François-Bernard Huyghe ; Jacques Lecarme ; Hélène Maurel-Indart ; Michel Melot ; Louise Merzeau ; Antoine Perraud ; France Renucci ; Monique Sicard.
Recently viewed items





